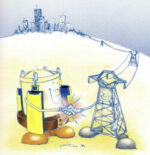Annonce et résumé du livre de Dominique Grenêche déjà auteur d’une bible des réacteurs « Histoire et techniques des réacteurs nucléaires et de leurs combustibles » (EdP Sciences).
André Lacroix
Les réacteurs nucléaires surgénérateurs : pourquoi ? Comment ? Quand ?
Plaidoyer pour un avenir énergétique durable et propre
Dominique Grenêche
PREFACE et RESUME
« Je ne blâme pas ni n’approuve, je raconte » – Charles–Maurice de Talleyrand
Préface
Vincent BERGER, Haut-commissaire à l’énergie atomique
Yves BRÉCHET, membre de l’Académie des sciences
Dominique Grenêche connait les réacteurs nucléaires. Cet infatigable ingénieur et physicien a étudié pendant plus de 50 ans pratiquement tous les types de réacteurs que l’imagination et le travail des hommes a produits. Il a arpenté des chemins des plus exotiques, à commencer par le Thorium lors de sa thèse, sous la direction de Jules Horowitz, au début des années 70 pour finir avec l’ensemble des conceptions qui sont envisagées pour les futures générations de réacteurs. Il a étudié les géométries de cœur les plus diverses, des bilans neutroniques en tout genre, au CEA. Il a travaillé sur la sureté des réacteurs pendant 7 ans à l’IRSN, puis sur le cycle des combustibles à Areva, enfin sur les risques de prolifération ou encore sur tous les plans de réacteurs de génération IV, au sein du forum international « Gen-IV », qui font l’objet de ce livre. Au sein des publications de cet ancien conseiller du haut-commissaire à l’Énergie atomique Robert Dautray, on trouve des études aussi exotiques que l’ajout de neptunium dans le combustible pour dégrader le Plutonium formé sous irradiation ou les difficultés de récupérer l’uranium de l’eau de mer… Il a beaucoup roulé sa bosse aux États-Unis, tant dans le cadre de ses nombreuses collaborations scientifiques avec des universités américaines ou avec le Department of Energy, qu’au directoire de l’American Nuclear Society pour y représenter l’Europe, que pour arpenter les routes de l’Idaho ou du Wyoming pour visiter les sites historiques du nucléaire américain. C’est-à-dire l’histoire.
Car une autre caractéristique essentielle de Dominique Grenêche, qui donne toute sa forme à cet ouvrage, est sa passion pour l’histoire. En témoigne les nombreuses anecdotes sur les personnages qui ont construit l’histoire du nucléaire (ainsi la reprise de la petite phrase d’Alvin Weinberg à propos de Wigner, lorsqu’il conçut le réacteur chargé de produire le Plutonium dans le projet Manhattan « quand je repense à ce concept de Wigner, je ne peux trouver qu’une analogie : Mozart »), en témoigne son annexe 1, qui reproduit intégralement le relevé de décision de la célèbre réunion du 26 avril 1944, réunion au cours de laquelle les premières idées de réacteurs surgénérateurs (« the mother plant ») et les caloporteurs appropriés (le mélange Plomb Bismuth, et déjà le sodium) étaient introduits par Fermi et Wigner. Lorsqu’il évoque la bible de 1958 de Wigner et Weinberg « the physical theory of neutron chain reactors », il rougit d’en posséder un exemplaire et emploie le « nous » de modestie : « nous le gardons précieusement dans notre bibliothèque ». On peut imaginer où Dominique Grenêche rêverait de voyager si une journée de son choix dans l’espace-temps lui était accordée. Ce serait dans cette réunion du « New Pile Committee » du 26 avril 1944 au Chicago Metallurgical Laboratory, à moins que ce ne soit dans le désert du Nouveau-Mexique pour le premier essai nucléaire Trinity, ou encore, tout simplement, au-dessus des épaules de Frédéric Joliot, Hans Halban et Lew Kowarski aux premiers jours de mai 1939, pour regarder leurs plumes écrire les trois fameux brevets originels des applications civiles et militaires de la physique nucléaire.
Cette passion pour l’histoire fait de Dominique Grenêche un conteur. Dans la discipline des études nucléaires parfois réputée un peu « sèche », très technique, comprenant au moins autant de considérations d’ingénieur que de belle physique, il réussit à embarquer son lecteur (un petit peu éclairé quand même : grands débutants s’abstenir) dans une aventure en cours, celle des neutrons rapides, une aventure commencée il y a 80 ans et qui ne se terminera pas avant 80 ans. Telles sont les échelles de l’ingénierie nucléaire : le temps long. C’est pour cela que les expériences réalisées dans les années 1950 ou 1980 sont encore si riches en information. C’est pour cela que les jeunes ingénieurs dans les start-up aujourd’hui consultent encore des comptes-rendus d’expériences sur les sels fondus menés aux États-Unis au milieu des années 1960 ou que les concepteurs de réacteurs à neutrons rapides solides vénèrent ce qu’ils appellent le « trésor Phénix », le monumental retour d’expériences en tout genre obtenu pour cette filière par le réacteur Français durant ses 35 années de fonctionnement, entre 1973 et 2008, et par la filière de retraitement et de recyclage de son combustible usé durant plus de 25 ans. Lorsque l’on parcourt les références de l’ouvrage de Dominique Grenêche, on est frappé par la pertinence encore actuelle de publications écrites au cours de décennies parfois lointaines. On mesure là pleinement la spécificité de cette discipline, lorsqu’on la compare au traitement naturel du langage, à l’information quantique ou à l’immunothérapie, où les dernières années recouvrent les autres et les publications se périment vite.
Il faut donc de la patience pour l’ingénieur dans le domaine du nucléaire, de la patience pour apprendre et pour se repérer dans cette riche histoire aux curiosités multiples, aux essais divers et variés, parfois réussis, parfois ratés, mais toujours porteurs de connaissance. Le nucléaire est un territoire peuplé de machines étranges, plus ou moins sophistiquées et parfois tordues, qui sont regroupées en famille, comme des espèces phylogénétiques, chaque famille comptant en son sein des individus singuliers, parfois célèbres. Ces machines ont pour noms EBR-I, Rapsodie, Phénix, Superphénix, BREST-300, et tant d’autres. Dominique Grenêche les connait toutes. En témoigne son ouvrage magistral sur les réacteurs nucléaires[1], devenu une référence dans ce domaine en France comme l’étranger et qui siège sur les bureaux de tous ceux pour qui le nucléaire est avant tout un sujet scientifique et technique.
Si ce premier livre de 766 pages constituait une sorte d’encyclopédie des réacteurs nucléaires, le présent ouvrage se concentre sur les réacteurs surgénérateurs et sur leur rôle dans le futur. Surgénérateurs, c’est-à-dire capables pendant leur fonctionnement de générer plus de combustible nucléaire qu’ils ne consomment. Il n’y a là nul mouvement perpétuel, comme ont pu l’écrire quelques journalistes idiots ou malintentionnés. La matière de base pour « générer » ce combustible en surplus est tout simplement de l’uranium 238, matière sous-utilisée dans les réacteurs actuels, mais qui compose pourtant plus de 99% de l’uranium naturel. C’est là tout l’intérêt des réacteurs surgénérateurs : alors que les réacteurs actuels utilisent principalement de l’uranium 235 pour fonctionner, qui représente seulement 0,7% de l’uranium naturel, les surgénérateurs permettent d’employer la totalité de l’uranium naturel et ouvrent les perspectives d’un nucléaire durable et d’une souveraineté de l’Europe en énergie pour des siècles. L’enjeu derrière ce livre n’est donc pas mince et il concerne tous les Français.
Dominique Grenêche est un physicien passionné et un ingénieur engagé. Il entend mener ici une véritable démonstration de la nécessité de remettre rapidement sur le métier l’ouvrage de la France vers la construction des réacteurs à neutrons rapides, surgénérateurs, qui se prépare depuis plus de 70 ans, avec des phases de progrès phénoménaux (Phénix) et des phases de pause (le « séisme » de l’arrêt de Superphénix en 1998, la décision de sursoir à la construction d’Astrid en 2019, qualifiée de « réplique » par Dominique Grenêche).
Le raisonnement est soigneusement étayé tout le long du livre avec tous les chiffres et toutes les références nécessaires. Il peut toutefois se résumer sommairement ainsi. Tout d’abord, l’approvisionnement en combustible uranium viendra à manquer avant la fin du siècle, en raison du développement du nucléaire mondial pour la décarbonation de l’économie et de la finitude des ressources, qui n’ont pas augmenté depuis trente ans, malgré des recherches soutenues notamment entre 2005 et 2015. Dominique Grenêche aurait pu approfondir le risque géopolitique qui pèse également sur la ressource en uranium, la majorité des ressources minières se trouvant dans des pays qui ne sont pas forcément nos alliés (des pays autour d’un bloc Chine-Russie) et qui sont les plus gros constructeurs de centrales nucléaires au monde. Les autres ressources (Canada, Australie) serviront certainement en priorité les États-Unis plutôt que l’Europe. Ces pays en mesure d’organiser la pénurie en uranium sont aussi ceux qui apporteront la solution : les réacteurs surgénérateurs, à neutrons rapides (RNR), qui ont été développés sans discontinuer depuis 60 ans par les Russes et depuis une dizaine d’années (mais ils ont rattrapé leur retard) par les Chinois. Ces deux pays sont devenus incontestablement aujourd’hui les plus avancés sur la construction des RNR et annoncent tous les deux des réacteurs commerciaux en 2035. Même les états unis, traditionnellement opposés à l’usage civil du Plutonium, sont actuellement dans la course avec l’initiative « Terrapower » de Bill Gates.
Si la France et l’Europe veulent éviter d’avoir à dépendre des Russes ou des Chinois pour acheter demain leurs réacteurs, si elles veulent construire une souveraineté énergétique, il est alors impératif de reprendre la construction d’un RNR et ensuite d’en construire plusieurs, dès que possible. Les RNR au sodium sont la voie à privilégier : tous les RNR électrogènes réalisés jusqu’à présent, dans neuf pays, ont privilégié la filière sodium. La France dispose de tous les atouts nécessaires pour transformer l’essai de Phénix et Superphenix précisément dans cette filière : une connaissance très riche de ces réacteurs et des développements non moins riches sur le cycle de ce combustible. Il est temps de reprendre l’histoire des RNR en France. Selon Dominique Grenêche, « le plus tôt sera le mieux ». Son impatience confine à l’agacement lorsqu’il conclut : « notre pays a besoin de stratèges, pas de chefs comptables ». Et de citer le général Douglas MacArthur : « les batailles perdues se résument en deux mots : trop tard ».
Ces quelques phrases, ces quelques éléments de langage rapidement jetés, ne doivent pas faire l’économie de la lecture attentive de ce livre. L’ingénieur y trouvera un cheminement complet des arguments et pourra se convaincre lui-même, en profondeur, du bien-fondé de l’ensemble du raisonnement.
Au-delà de la référence constante aux éléments historiques, déjà évoqués, le lecteur trouvera enfin ici un style, qui n’est pas pour rien dans la dimension pédagogique de l’ouvrage. Un style vivant, engagé, qui rompt parfois avec le style typique de l’ingénieur pour emprunter à celui du polémiste et qui contribue à tenir le lecteur en haleine. Ici, à propos d’une option discutable sur Astrid, « Enrico Fermi se retourne dans sa tombe ». Là, l’arrêt de Superphenix devient une « peine capitale ».
Parfois un seul mot tient lieu de phrase : ainsi, « GRANDEUR », lorsque l’auteur s’arrête un instant sur la France de la fin des années 80. C’est peut-être le mot à retenir à la fin de ce livre, qui se termine par une impatience voire une frustration. La frustration que l’on sent chez son auteur, Dominique Grenêche, concerne ce je-ne-sais-quoi qui fait encore défaut aujourd’hui, selon lui, à la France, pour décider, pour transformer l’essai, pour développer enfin les RNR et ainsi poursuivre l’histoire du nucléaire, atteindre sa souveraineté énergétique. Qui fait encore défaut aujourd’hui, mais peut-être pas demain : la GRANDEUR.
Résumé
Ce livre est né de l’incompréhension totale de l’auteur et de beaucoup d’autres concernant la décision subite et furtive prise en août 2019, d’abandonner le projet de prototype de réacteur à neutrons rapides (RNR) Astrid, pourtant prévu par la loi du 28 juin 2006. Cette loi stipule en effet dans son article 3 qu’il faut mettre en exploitation un prototype de réacteur nucléaire de nouvelle génération avant le 31 décembre 2020.
Le propos de ce livre est de montrer que le déploiement à grande échelle des RNR surgénérateurs de matière fissile est essentiel pour assurer la pérennité de l’énergie nucléaire. Nous expliquons pourquoi il est nécessaire d’engager dès maintenant un programme vigoureux de développement de RNR. Différer leur développement, ce serait prendre le risque qu’ils ne soient pas au rendez-vous pour se substituer aux réacteurs nucléaires actuels qui utilisent comme seul « carburant » l’uranium naturel, dont les ressources exploitables vont fatalement se raréfier au tournant de ce siècle. Ce livre vise donc à apporter et à analyser tous les éléments qui justifient cette nécessité. Ils sont étayés par des faits et des chiffres qui sont incontestables, tout au moins par « l’honnête homme ».
Chapitre 1 : Les enjeux de l’approvisionnement énergétique mondial
Nous présentons, les enjeux actuels et futurs de l’approvisionnement mondial en ÉNERGIE. Nous montrons notamment que l’énergie est VITALE pour nos sociétés, en fournissant quelques points de repère tirés de notre vie courante. Nous examinons ensuite les composantes de l’équation énergétique mondiale actuelle et future montrant qu’il n’est pas possible de trouver des solutions crédibles et durables sans une contribution importante d’énergie nucléaire. Nous procédons par ailleurs à une analyse fouillée de tous les impacts environnementaux des différentes sources d’énergie qui placent l’énergie nucléaire sur la plus haute marche du podium.
Chapitre 2 : La surgénération de matière fissile
Nous expliquons le « secret » de la surgénération de matière fissile que l’on illustre par des analogies qui permettent de bien comprendre le principe de ce phénomène exceptionnel. Nous démontrons que le SEUL MOYEN d’y parvenir est d’utiliser du PLUTONIUM comme matière fissile et que c’est physiquement impossible avec de l’uranium enrichi, quel que soit le niveau d’enrichissement.
Chapitre 3 : Historique et types de RNR
Nous retraçons l’origine du concept de surgénération qui fut présenté pour la première fois par le génial physicien Enrico Fermi au cours d’une réunion réunissant une dizaine d’éminents scientifiques qui s’est tenue le 26 avril 1944, dont nous donnons le compte rendu en annexe. C’était il y a 80 ans. Nous relatons les premiers travaux sur les RNR menés aux États-Unis après la guerre, qui ont abouti à la réalisation et au fonctionnement en août 1951 du premier réacteur nucléaire civil au monde de production d’énergie qui était un RNR (EBR1, Experimental Breeder Reactor). Nous présentons ensuite les différents types de RNR pour lesquels l’élément structurant est le fluide caloporteur, et nous comparons les mérites et les faiblesses liés aux deux choix possibles de fluides sous forme de métaux liquides que sont le sodium et le plomb ou en utilisant. Nous examinons également l’option du gaz qui est étudiée par certains pays, dont la France ainsi que celle des réacteurs à sel fondu (RSF) surgénérateurs, qui fait l’objet de travaux de R&D dans plusieurs pays, notamment pour les petits réacteurs modulaires (SMR) proposés en France par certaines startups. Nous présentons par ailleurs un panorama des différents types de combustibles de RNR, que sont les oxydes, les métaux, les carbures et les nitrures. À l’issue de cette analyse, il apparait que le SODIUM constitue la solution la plus adaptée pour un développement des RNR de grande puissance, dans les meilleurs délais, compte tenu de l’expérience unique dont bénéficie cette filière (500 réacteurs-ans) qui a d’ailleurs fait l’objet d’un consensus technique quasi unanime dans le passé. En témoigne le recensement de tous les réacteurs expérimentaux et tous les réacteurs électrogènes qui ont fonctionné dans les 9 pays qui ont choisi de mettre en œuvre cette technologie du sodium comme fluide caloporteur. Soulignons néanmoins que les autres fluides caloporteurs (Plomb, gaz, RSF) peuvent apporter des alternatives intéressantes à plus long terme, notamment pour les SMR, et méritent donc d’être étudiés.
Chapitre 4 : Questions génériques et cycle du combustible
Nous analysons des questions génériques en commençant par cycle du combustible. Nous apportons notamment les preuves que notre pays possède une solide expérience dans ce domaine puisque des installations pilotes de traitement et de recyclage du plutonium ont été construites et exploitées avec succès dans le passé. Ce sont des faits qui contredisent les affirmations de certains hauts responsables qui, pour justifier l’arrêt d’Astrid, ont affirmé que l’on n’a pas « regardé le cycle ». Nous examinons ensuite la question des déchets pour montrer que les RNR sont en mesure de les gérer au mieux en réduisant les quantités produites et en permettant au besoin d’en éliminer une partie. Nous abordons également le thème du risque de prolifération nucléaire en clarifiant quelques notions souvent mal appréhendées. À l’issue de cet examen, il apparait que les RNR n’augmentent pas ce risque, au demeurant très faible, par rapport aux réacteurs actuels. Pour les RNR au sodium, c’est même l’inverse du fait de la barrière supplémentaire que constitue le sodium liquide pour les manipulations d’assemblages irradiés. Ce danger parfois agité comme un chiffon rouge n’a donc aucune réalité tout au moins pour des installations placées sous les garanties de l’AIEA et qui sont soumises aux inspections régulières et aux contrôles continus exercés par cette agence internationale qui fait autorité. Enfin, sur le plan économique, nous analysons toutes le données disponibles qui montrent que le surcoût de production électrique d’un RNR au sodium avec son cycle du combustible par rapport à un REP se situe tout au plus à 20 %.
Chapitre 5 : Échéance et déploiement des surgénérateurs
Nous procédons à une analyse fouillée des scénarios de développement de l’énergie nucléaire dans le monde qui sont échafaudés par les grands organismes internationaux, afin d’estimer l’échéance la plus réaliste à laquelle les surgénérateurs devront être massivement déployés pour éviter que l’énergie nucléaire soit confrontée à de sérieuses difficultés d’approvisionnement en uranium naturel. Nous examinons pour cela les données les plus crédibles concernant les ressources en uranium connues ou probables, voire spéculatives en fonction de leur coût d’extraction. Nous montrons alors que dans tous les cas envisagés, on s’achemine vers une raréfaction des ressources conventionnelles identifiées en uranium naturel économiquement exploitables au tournant de ce siècle ou au début du siècle prochain. Nous passons ensuite en revue toutes les options qui pourraient permettre de repousser cette échéance, y compris le recours à des ressources non conventionnelles telles que celles contenues dans les phosphates ou l’eau de mer, ou encore l’uranium qui pourrait être récupéré par le réenrichissement de l’uranium appauvri. Nous examinons également la possibilité de recourir à de nouvelles technologies permettant une meilleure utilisation de l’uranium dans les réacteurs de troisième génération, ou encore le recours au cycle au thorium. À cette occasion, nous montrons que le multirecyclage du plutonium dans nos réacteurs à eau pressurisée, appelé curieusement cycle « semi fermé » (AOC française), conduit à des économies en uranium de quelques pour cent seulement. Cette analyse démontre qu’il n’existe aucun moyen crédible susceptible de décaler significativement l’échéance de raréfaction des ressources en uranium au-delà du début du siècle prochain. Face à une telle perspective, on peut craindre que des investisseurs ou même des gouvernements hésiteront à financer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires de troisième génération s’ils n’ont pas de garanties suffisantes permettant de s’assurer qu’ils pourront être alimentés en combustible à des prix raisonnables pendant toute leur durée de fonctionnement prévue au minimum à 60 ans. Dès lors, il convient d’examiner quelles sont les contraintes qui peuvent peser sur ce rythme de déploiement des RNR. À cet égard, on constate que le principal obstacle susceptible d’entraver le rythme de déploiement des RNR est celui de la DISPONIBILITÉ du PLUTONIUM qui, on l’a vu, est le seul carburant permettant d’atteindre la surgénération. Mais il faut aussi tenir compte de l’inertie qui caractérise la réalisation de nouveaux de projets dans le secteur nucléaire, ainsi que des limites raisonnables liées aux capacités des installations du cycle du combustible. Ces considérations révèlent que la mise en place d’un parc nucléaire constitué principalement de RNR surgénérateurs ne peut pas s’envisager en pratique avant le début du siècle prochain. Ce dernier chapitre est l’occasion de présenter et de commenter les trois grandes périodes du développement des RNR en France : la grandeur depuis les années 1950 jusqu’à la fin des années 1990 où la France s’est hissée au premier rang mondial de maitrise de cette technologie, la décadence avec l’assassinat en plein vol du réacteur Superphénix en 1997 qui était alors le plus puissant de la planète, la dérobade récente du programme de développement de cette filière nucléaire aux atouts exceptionnels. Pendant ce temps-là, plusieurs autres grands pays nucléaires s’engagent résolument dans ces programmes comme le montre le panorama des activités internationales qui est présenté pour clore ce dernier chapitre.
Au terme de cette analyse, il se confirme que notre souveraineté énergétique ne peut être assurée que par le recours massif à l’énergie nucléaire, qui est une grande chance pour notre pays. Mais pour garantir la pérennité de cet avantage majeur, il est de la plus haute importance de relancer au plus vite la réalisation d’un programme d’envergure sur les réacteurs surgénérateurs. À cet égard, la construction d’un démonstrateur industriel doit être engagée au plus vite. Cette décision serait d’autant plus fondée que nous sommes le seul pays au monde qui rassemble tous les atouts pour déployer ces RNR à grande échelle. En, effet, nous possédons une expérience unique au monde sur cette technologie, grâce à notre vaste programme passé de R&D couronné par la construction et l’exploitation des RNR de puissance Phénix et Superphénix. Nous bénéficions en outre d’un savoir-faire industriel inégalé sur le traitement de combustibles usés et le recyclage du plutonium qui sont nécessaires au fonctionnement des RNR. Enfin, nous avons accumulé sur notre territoire d’énormes quantités d’uranium appauvri qui sécurisent l’alimentation d’un parc ce RNR pendant plusieurs milliers d ‘années et qui élimine ainsi tous nos besoins d’importation d ‘uranium naturel.
Il s’agit à l’évidence d’un enjeu stratégique pour l’avenir énergétique à long terme de la France et pour la lutte efficace contre le réchauffement climatique via le développement d’un moyen de production massive d’énergie décarbonée. Repousser la décision de construction d’un prototype industriel ferait courir le risque de perdre tous les bénéfices de la stratégie d’anticipation suivie jusqu’à présent, qu’il s’agisse du maintien des compétences ou de la préservation des stocks de matières valorisables.
En conclusion, il est urgent de prendre des décisions qui dépassent largement les agendas politiques ou les luttes d’influence. Faute de quoi, il ne nous restera plus qu’à acheter des RNR « made in China » ! Nos grands décideurs n’auront plus alors qu’à méditer la déclaration du Général Douglas MacArthur : « Les batailles perdues se résument en deux mots : trop tard ! »
* * * * * *
[1] « Histoire et techniques des réacteurs nucléaires et de leurs combustibles », EdP Sciences, 2016.