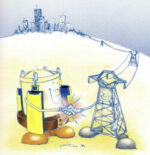Rien de nouveau sur le fond dans cet article de Géraldine Woessner, dans « Le Point », qui décrit les conclusions peu complaisantes du Rapport de l’Académie des Sciences : plans irréalistes, objectifs mal définis…Puissent elles être entendues par nos politiques et nos décideurs !
André Lacroix
C’est la énième histoire d’un emballement politique. En 2021, un Emmanuel Macron exalté annonçait, depuis Béziers, un investissement de 2 milliards d’euros pour booster la jeune filière hydrogène, présentée comme « un tout nouveau continent qui s’ouvre devant nous ». Renforcée par la guerre en Ukraine qui a brutalement coupé l’Europe du gaz russe, l’ivresse a saisi les dirigeants de l’Union à propos de ce gaz « miracle », présenté comme capable, demain, de faire rouler nos voitures, voler nos avions et tourner nos usines sans dégager autre chose que de la vapeur d’eau ! Une aubaine pour des dirigeants confrontés au défi de décarboner leurs économies tout en conversant de la croissance.
Partout, les subventions pleuvent sur la petite molécule, et la France, comme ses voisins, affiche fièrement des objectifs ambitieux, consacrés par un « plan hydrogène » doté de 9 milliards dans le cadre de France 2030. Une somme colossale, que les régions dépensent aujourd’hui allègrement, multipliant les projets dans toutes les directions. Ici, on subventionne un électrolyseur. Là, un « corridor hydrogène » pour implanter des stations routières, ailleurs des flottes de bus et de camions poubelles… En pure perte ?
Pour la première fois depuis plus de 10 ans, l’Élysée s’est tourné vers l’Académie des sciences, depuis peu présidée par le Pr Alain Fischer (qui présida, pendant la crise du Covid, le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale), pour éclairer sa réflexion. Et le rapport, s’il souligne la pertinence d’une stratégie française axée sur la production locale et rétive aux importations, douche quelques espoirs.
Les plans « irréalistes » du gouvernement sur l’hydrogène
« Les plans du gouvernement n’ont aucune chance de se réaliser, et si l’on ne priorise pas les usages qu’on fera de cet hydrogène vert, il sera impossible de changer d’échelle », tranche froidement le spécialiste des systèmes énergétiques et professeur au Collège de France Marc Fontecave, qui a passé plusieurs mois, à la demande de l’Élysée, à étudier le sujet avec les meilleurs spécialistes. Remis le 9 avril au chef de l’État, leur rapport confirme les alertes lancées depuis longtemps par le monde scientifique, restées jusqu’à présent passablement inaudibles. L’hydrogène vert, concluent les experts, offre bel et bien de formidables perspectives pour remplacer les sources d’énergies fossiles. Mais sa production soulève de tels défis que les cibles fixées doivent être « raisonnables » et rigoureusement encadrées, au risque de se réveiller avec une sévère gueule de bois, et les poches vides…
L’engouement pour l’hydrogène (H2), élément de plus abondant de l’univers, est compréhensible : combiné à de l’oxygène, il détone à la première étincelle en produisant trois fois plus d’énergie que l’essence, et en ne rejetant rien d’autre que de la vapeur d’eau. Aujourd’hui, ce gaz est essentiellement produit en cassant une molécule de méthane (CH4) ou par l’oxydation d’hydrocarbures, des méthodes extrêmement polluantes. Mais les technologies modernes permettent de l’extraire en cassant, par un courant électrique, une molécule d’eau (H2O). Si l’électricité servant à alimenter l’électrolyseur est elle-même bas carbone, le tour est joué : l’hydrogène « vert » pourra se substituer aux énergies fossiles, en modifiant au minimum les infrastructures aujourd’hui adaptées au gaz fossile.
Chaque million de tonnes d’hydrogène vert produit par électrolyse nécessite environ 55 TWh d’électricité, soit l’équivalent de 5 réacteurs EPR. »
Marc Fontecave
La France comme l’Europe, emballées, ont lancé des plans prévoyant une hausse colossale de la consommation d’hydrogène vert d’ici 2050. Alors que l’Europe consomme aujourd’hui environ 10 millions de tonnes d’hydrogène, pour le raffinage du pétrole, la fabrication d’engrais ou l’industrie chimique, le niveau envisagé à l’horizon 2050 est de 60 millions de tonnes d’hydrogène vert, dont la moitié serait produite sur le territoire européen, le surplus d’électricité fourni par les énergies renouvelables devant alimenter les électrolyseurs. Le reste serait importé de pays du sud, on ignore encore comment. La France, plus modeste, prévoit de passer d’une consommation de 900 000 tonnes d’hydrogène consommées aujourd’hui, essentiellement gris, à 1 million de tonnes d’hydrogène vert dès 2035, et selon les scénarios, jusqu’à 4 millions de tonnes.
Limites physiques
Des objectifs jugés par beaucoup totalement utopiques, compte tenu de la quantité d’énergie nécessaire au processus d’électrolyse. « Chaque million de tonnes d’hydrogène vert produit par électrolyse nécessite environ 55 TWh d’électricité, soit l’équivalent de 5 réacteurs EPR de 1 600 MW ! » explique Marc Fontecave. En clair, pour respecter ses plans, l’Europe devrait produire 1 700 TWh d’électricité bas carbone supplémentaires, ce qui représente plus de 60 % de toute l’électricité qu’elle consomme aujourd’hui.
La France, qui dispose d’un avantage incontestable grâce à son parc nucléaire, pense (à raison) avoir un rôle à jouer dans la production d’hydrogène vert. Elle affiche des objectifs certes plus modestes, mais qui restent inatteignables : verdir sa consommation actuelle d’hydrogène, promesse avancée pour 2030, avalerait la production de 5 réacteurs EPR. Et il en faudrait 20 supplémentaires pour atteindre une production de 4 Mt. L’éolien offshore ne prendra pas le relais : pour respecter les plans du gouvernement, « il faudrait construire 36 à 40 nouveaux parcs d’ici 2035 ».
L’Académie des sciences appelle à la lucidité : cela n’arrivera pas. Il n’y aura pas non plus assez d’électrolyseurs : la Stratégie française énergie climat (SFEC), adoptée à l’automne 2023, prévoit 6,5 GW d’électrolyseurs installés en 2030, et 10 GW en 2035. Or « à la fin de l’année 2023 », documente le rapport, « la puissance d’électrolyseurs installés n’était que de 0,03 GW ». En clair : à six ans de l’échéance, la France a rempli 0,5 % de son objectif, et seulement 5 % en tenant compte des projets en cours ou ayant reçu une décision finale d’investissement.
L’Académie des sciences appelle à changer le tir
Une réalité qui révèle les freins limitant encore le développement de la filière : contraintes scientifiques et technologiques liées au rendement et à la stabilité des électrolyseurs, défis liés au transport de la molécule (que l’Europe envisage d’importer de pays ensoleillés), coûts de production encore très élevés… « L’écart entre le prix du kg d’hydrogène vert et celui de l’hydrogène gris reste élevé et stable dans le temps. Alors que le second se situe entre 1 et 2 €/kg, le premier est en moyenne 4 fois plus élevé, se situant entre 4 et 8 €/kg, selon la technologie utilisée », note le rapport. Un différentiel qui refroidit les investisseurs, et explique que la demande d’hydrogène vert reste faible.
D’où l’appel de l’Académie à rectifier le tir, en revenant à des objectifs réalistes, et en ciblant les efforts à la fois sur la production actuelle d’hydrogène gris, pour la décarboner, et sur ceux qui ne pourront pas se passer d’hydrogène : industrie de l’acier, du ciment, certains transports lourds, notamment maritime… « Aujourd’hui, les milliards du plan France Relance se dispersent sur des dizaines de projets sans avenir, dont l’impact climatique sera ridicule, déplore Marc Fontecave. Aucun arbitrage n’est réalisé. »
Pour aider au développement de la filière, l’Académie dresse une série de recommandations : soutenir les projets d’exploration d’hydrogène naturel (aujourd’hui, nul ne sait si cette ressource, récemment découverte, est abondante ou pourra être exploitée), orienter les projets vers la décarbonation de l’hydrogène gris actuel ou quelques usages essentiels, augmenter rapidement les capacités de production électrique décarbonée et d’électrolyse, poursuivre une recherche forte, et surtout arbitrer, « définir des priorités. » Car « les objectifs non réalisables ne seront pas réalisés, et cela conduira le citoyen à considérer que les gens à la tête des affaires sont soit des incompétents, soit des menteurs », s’inquiète Marc Fontecave.